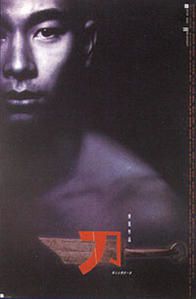
Un film de Tsui Hark
Titre original : Dao
Hong Kong (1995)
Action (env. 1h41)
Avec : Chiu Man-cheuk, Valérie Chow, Xin Xin Xiong, Moses Chan, Collin Chiou…
Résumé : En des temps reculés, dans une province chinoise où règnent le chaos et la misère, le jeune forgeron Ding On, découvre par hasard que son père fut tué par un étrange brigand au corps recouvert de tatouages et ayant la capacité de voler. Bouleversé par la nouvelle, il vole la lame de son père, qui fut brisée lors de l’affrontement de ce dernier avec le « tatoué », et s’enfuit de chez son maître, un grand armurier qui l'a recueilli lorsqu’il n’était qu’un nourrisson. En chemin il se retrouve mêlé à une bagarre avec des brigands, dans laquelle il perd son bras droit. Transporté et soigné par un jeune paysan « Noiraud », orphelin lui aussi, Ding On manchot et humilié, décide de s’exiler de son entourage. Après une nouvelle attaque d’hors la loi où il est de nouveau torturé, il trouve un manuel de Kung -Fu qui va lui permettre de tirer toute sa force de son handicap…
The Blade est né de l’énervement de son réalisateur Tsui Hark, qui déplorait alors à l’époque le manque de renouvellement de forme dans le cinéma d’action et dans le wu xia pan (film de sabre chinois), genre encore très peu connu en occident. Nous sommes dans le milieu des années 90 et il faudra attendre encore quelques années avant que des films comme Tigre & Dragon apparaissent sur nos écrans et fassent connaître à un public large, un genre que l’on pourrait comparer chez nous à nos films de cape et d’épée (un cinéma malheureusement mort et enterré depuis longtemps) qui remonte au début du cinéma chinois. Le but du film est donc clair : renouveler tout un pan du cinéma asiatique, rien que ça ! Et qui d’autres que le maître Tsui Hark pouvait réussir un tel pari ? Personne sans doute.
Hommage au maître

Pour que la révolution ait lieu, le réalisateur se devait de revenir à la base de ce cinéma pour se détacher de tout ce qui avait été fait avant et ainsi proposer quelque chose de nouveau. C’est pour cela qu’il choisit de se réapproprier l’un des mythes les plus populaires du genre : celui du sabreur manchot. S’inspirant déjà du cinéma japonais et notamment de la saga des Zatoichi, Chang Cheh révolutionna le wu xia pan fin des sixties avec The One-Armed Swordsman (Un seul bras les tua tous), dont l’histoire raconte comment un homme manchot va surmonter son handicap grâce aux arts-martiaux. Enorme succès à l’époque, le film connaîtra deux suites Return of the One-Armed Swordsman (Le bras de la vengeance) et The New One-Armed Swordsman (La rage du Tigre) qui est en fait une relecture du premier opus. Tout comme ce dernier, The Blade est loin d’être un simple remake de l’original mais plutôt une réinterprétation personnelle du mythe, tout en étant un vibrant hommage à l’un de ses « maîtres », Chang Cheh lui-même. La trame du film, quelques éléments de l’œuvre originale, le personnage manchot (logique !), le manuel de Kung Fu, l’intervention du héros entre son maître et le méchant… et une violence très graphique qui lie les deux œuvres entre elles. Néanmoins ce sont là les seuls points communs. Aujourd’hui le cinéma de Chang Cheh est devenu classique et Tsui Hark est décidé à faire évoluer, une fois de plus, le wu xia pan dans la modernité.
Sur le terrain

Etant donc lassé du
wu xia pan traditionnel avec ses combats aux chorégraphies câblées et fluides, à la mise en scène stylisée (je pense en particulier au raffinement des films de Chu Yan), Tsui Hark va adopter une ligne directrice complètement différente de ce qui se fait à l’époque et qu’il appellera l’ « action-vérité ». Premièrement et contrairement aux autres œuvres du genre se situant dans la Chine ancestrale, l’époque de l’histoire n’est pas définissable, aucuns repères temporels n’étant là pour nous aider, les évènements pouvant très bien se dérouler dans un futur apocalyptique à la
Mad Max, à tel point qu’on aurait pas été surpris de voir une carcasse de voiture ou les ruines d’un immeuble dans les arrières plans. Deuxièmement il souhaite un cinéma d’action emprunt de réalisme, qui se rapproche le plus d’une certaine crédibilité, d’une vérité qui se traduit à travers sa mise en scène. Pour cela, il favorise l’improvisation dans chaque angle de la création : que ce soit dans le scénario qu’il prive de tout dialogue (le réalisateur écrira au jour le jour quelques dialogues directifs qui imposeront aux acteurs la lourde tâche d’improviser tout le long du tournage), l’absence de points de repères positionnels pour les comédiens obligeant le cadreur à être réactif à leur jeu, ou encore les scènes de combats dont les prouesses martiales, sans câbles, sont exécutées par les acteurs… Une approche révolutionnaire dans la manière d’aborder le cinéma d’action (qu'il réappliquera au polar dans
Time & Tide), pas si éloigné de celle du « cinéma vérité » d’une certaine Nouvelle Vague française. Il est d’ailleurs amusant de remarquer que pratiquement au même moment, un autre réalisateur de film d’action, appliquera des principes semblables. En effet, John Mctiernan n’a-t-il pas réalisé
Une Journée en Enfer avec ses scènes d’explosions et de poursuites, tournées dans les rues de New York en plein jour ? Un détail intéressant qui permet de faire un rapprochement entre les deux hommes. Mais ce n’est pas le sujet.
Ran

Par une mise en scène quasi-documentaire (certaines images semblent prises par un reporter de guerre), la volonté de Tsui Hark est de construire un espace réel qui prendrait vie sous les yeux du spectateur, mais elle est aussi de le déconstruire. Dès les premières scènes, le film dévoile très bien son thème central : le chaos. La société humaine que dépeint du film n’est régit que par la violence et les instincts bestiaux (l’attraction du personnage de Tête d’Acier pour la prostitué) où le but de chaque être est la survie avant tout. Un monde dans lequel le bien ne triomphe pas forcément (le meurtre sauvage du moine bouddhiste). L’un des buts de Tsui Hark est donc de mettre en scène le chaos à tel point que la première vision du film nous donne la sensation d’une œuvre désordonnée voire complètement bordélique (ellipses brutales, montage rapide et nerveux…) alors qu’au deuxième visionnage l’ensemble paraît d’une incroyable cohérence, ce qui démontre une nouvelle fois qu’un film de Tsui Hark doit toujours être vu au moins 2 fois. Tout comme la technique de combat du manchot Ding On dont l’équilibre et la force sont tirés du déséquilibre du personnage, c’est par la déconstruction d’une réalité agencée que Tsui Hark va pouvoir peu à peu insuffler à son œuvre une nature chaotique. Au risque de briser certaines règles du 7ème art : lors du flash back montrant la mort du père de Ding On, on peut voir un spot d’éclairage en plein milieu d’un plan, la dissymétrie des costumes, de simples pièces de tissus que les comédiens devaient agencer comme ils le pouvaient, la mise au point est parfois aléatoire… des détails qui confère un aspect brutal et rugueux au film.
L’enfer des armes

Le chaos est le fruit de la violence et la violence est le fruit des armes. Le début du film nous montre le rituel qui prend lieu chaque année dans l’armurerie qui se définit par une prière à la lame brisée, ensuite les employés s’entaillent le bras pour récolter un peu de sang sur un tissu qu’ils offrent à la lame. Le maître de l’armurerie par ce rituel espère ainsi se protéger et sa famille du malheur tout comme il cache les origines de son protégé Ding On, craignant qu’il s’engouffre sur la voie de la vengeance. Mais bien qu’il ne soit pas un guerrier, il n’exerce pas la violence et donc il pense qu’il échappera à son cercle vicieux mais il n’en demeure pas moins qu’il fabrique des armes destinés à tuer et il est donc naturel qu’un jour la violence qu’il redoute tant, lui retombe dessus. Dans le final, son armurerie est attaquée par le « tatoué » et ses hommes qui réussissent à pénétrer en se faisant passer pour des villageois attaqués. D’abord fouillés ils entrent et se ruent sur les armes fraîchement fabriqués massacrant ainsi toute personne sur leur chemin. Le message est clair, celui qui vit par les armes meurt par les armes. The Blade est donc un film sur les armes et plus précisément sur une arme, celle qui donne son titre au film. La lame qui fut brisée lors de l’affrontement entre « le tatoué » et le père de Ding On qui y trouva la mort. Elle est le véritable personnage central du film. Tout les évènements de l’histoire tourne autour de cette arme, lui procurant alors une dimension fantastique : elle est d’abord objet de culte, puis elle est enterrée avec le bras de Ding On et enfin elle est déterrée et « ressuscite » après que ce dernier est trouvé le manuel de Kung Fu. On pourrait même dire qu’elle est vivante et qu'elle possède une volonté propre. Lorsque Ding On se lie à son arme par une chaîne, est-ce la lame qui devient prisonnier de lui ou le contraire ? Est-ce Ding On qui tue accidentellement la prostituée ou bien est-ce la volonté de la lame ? Il faut dire que cette scène manipule très bien l’ambiguïté et que les deux cas se valent. En adoptant la voie de la lame, Ding On opte pour celle de la violence car toute personne liée à cette arme semble être condamnée à semer la mort autour d’elle, ou voir cette dernière s’exercer sur son entourage.
Happy End ?

Le ton du film est profondément pessimiste et même si la fin apparaît comme heureuse, elle peut être perçue de manière totalement opposée. En effet, le spectateur a plus l’impression d’assister au fantasme de la narratrice du film, la fille du maître de l’armurerie qui recluse seule, s’imagine que Ding On et Tête d’acier reviennent à ses côté même si cela paraît assez peu crédible. Après c’est selon la sensibilité de chacun de comprendre cette fin, mais quelle que soit la manière dont on aborde son œuvre, Tsui Hark, a réussi à produire une œuvre singulière et unique de part son approche stylistique, sa folie furieuse (les scènes de combats, surtout la scène finale, sont vraiment impressionnantes) et son scénario en apparence simpliste mais incroyablement riche de sens… qui fut injustement passée inaperçue lors de sa sortie en salle. Mais le temps guéri parfois les blessures et aujourd’hui le film est enfin reconnu à sa juste valeur. The Blade reste à ce jour l’un des meilleurs wu xia pan de tout les temps et une pièce maîtresse dans la filmographie de son auteur, la plus noire et la plus énervée (la scène du chien, les images de cadavres écorchés vifs), Tsui Hark y ayant mis toute sa rage. Car on peut dire que le film fut enfanté dans la douleur : les conditions de tournage furent tellement pénibles et fatigantes, que le réalisateur quittera le plateau dès la mise en boîte du dernier plan laissant l’équipe seule. Depuis il éprouve une amertume par rapport au film qu’il ressent comme un échec. Détrompez-vous Mr. Hark ! Vous êtes loin d’avoir échoué. Au contraire c’est ce qu’on peut appeler une totale réussite.
Pour faire court : En revenant au mythe du sabreur manchot, Tsui Hark révolutionne le wu xia pan et le cinéma d’action en général par une approche réaliste et sauvage. Tout simplement magistral !
 Un film d’Emanuele Crialese
Un film d’Emanuele Crialese





 Un film de Zhang Yimou
Un film de Zhang Yimou
 S’il est bien une chose qu’on ne peut pas reprocher à Zhang Yimou c’est la grande qualité graphique de ses films, notamment son travail sur les couleurs. Cultivant un goût maniaque pour le souci du détail et l’harmonie visuelle, le réalisateur en rajoute une couche ici, et une sacrée ! Muni d’un budget plus que confortable pour une production locale (45 000 000$) il est clair que le réalisateur s’en est donné à cœur joie. Les décors, les costumes, les accessoires… tout y est flamboyant, chaque détail est d’une beauté à couper le souffle, cultivant le plaisir des yeux. Si seulement tout le reste était à la hauteur.
S’il est bien une chose qu’on ne peut pas reprocher à Zhang Yimou c’est la grande qualité graphique de ses films, notamment son travail sur les couleurs. Cultivant un goût maniaque pour le souci du détail et l’harmonie visuelle, le réalisateur en rajoute une couche ici, et une sacrée ! Muni d’un budget plus que confortable pour une production locale (45 000 000$) il est clair que le réalisateur s’en est donné à cœur joie. Les décors, les costumes, les accessoires… tout y est flamboyant, chaque détail est d’une beauté à couper le souffle, cultivant le plaisir des yeux. Si seulement tout le reste était à la hauteur.  ouvertement et préfère citer des références étrangères plus « prestigieuses » : au vu de l’histoire du film, il paraît assez évident que Zhang Yimou espère avec La cité interdite égaler Le château de l’araignée de Kurosawa. Une ambition prétentieuse qui aurait pu réussir si le film n’était pas totalement artificiel. Tout comme son magnifique décor principal qui peine à dissimuler une famille en proie à la déchirure, l’éclat des décors tente de cacher une intrigue convenue et des personnages réduits à l’état de marionnettes, vides de toute chair et de sang, ne prenant jamais vie (dommage pour l’interprétation impériale de Chow Yun Fat, qui effectue son grand retour au cinéma). On espérait trouver une œuvre dynamique, aux multiples affrontements à l’épée ; on se retrouve face à une tragédie grecque rébarbative, mollassonne et ennuyeuse, à la mise en scène académique (pillant celle du chef d’œuvre Rebellion de Masaki Kobayashi), grandement dépourvue d’action.
ouvertement et préfère citer des références étrangères plus « prestigieuses » : au vu de l’histoire du film, il paraît assez évident que Zhang Yimou espère avec La cité interdite égaler Le château de l’araignée de Kurosawa. Une ambition prétentieuse qui aurait pu réussir si le film n’était pas totalement artificiel. Tout comme son magnifique décor principal qui peine à dissimuler une famille en proie à la déchirure, l’éclat des décors tente de cacher une intrigue convenue et des personnages réduits à l’état de marionnettes, vides de toute chair et de sang, ne prenant jamais vie (dommage pour l’interprétation impériale de Chow Yun Fat, qui effectue son grand retour au cinéma). On espérait trouver une œuvre dynamique, aux multiples affrontements à l’épée ; on se retrouve face à une tragédie grecque rébarbative, mollassonne et ennuyeuse, à la mise en scène académique (pillant celle du chef d’œuvre Rebellion de Masaki Kobayashi), grandement dépourvue d’action.  De l’action qui quand celle-ci pointe le bout de son nez déçoit cruellement. Que ce soit dans les duels rapprochés, aux chorégraphies peu inspirées et illisibles, pourtant signées Ching Siu Tung (Histoires de fantômes chinois), que dans les affrontements de masses dépourvus de souffle épique, au statisme frustrant, misant juste sur ses effets spéciaux moches et mal utilisés. On ne pensait pas que Zhang Yimou ferait pire que son précédent film Le secret des poignards volant, ben si ! Preuve qu’il est temps pour son auteur de revenir à ce qu’il sait faire de mieux, c'est-à-dire le drame intimiste façon Epouses & concubines, et laisser le soin à des hommes comme Tsui Hark de faire briller le wu xia pan partout dans le monde. A chacun son métier.
De l’action qui quand celle-ci pointe le bout de son nez déçoit cruellement. Que ce soit dans les duels rapprochés, aux chorégraphies peu inspirées et illisibles, pourtant signées Ching Siu Tung (Histoires de fantômes chinois), que dans les affrontements de masses dépourvus de souffle épique, au statisme frustrant, misant juste sur ses effets spéciaux moches et mal utilisés. On ne pensait pas que Zhang Yimou ferait pire que son précédent film Le secret des poignards volant, ben si ! Preuve qu’il est temps pour son auteur de revenir à ce qu’il sait faire de mieux, c'est-à-dire le drame intimiste façon Epouses & concubines, et laisser le soin à des hommes comme Tsui Hark de faire briller le wu xia pan partout dans le monde. A chacun son métier. Plutôt que de réaliser un biopic fidèle et classique pour évoquer les dernières heures du sénateur Robert F. Kennedy, assassiné le 5 juin 1968, Emilio Estevez préfère s’intéresser aux anonymes. En l’occurrence ceux de l’hôtel Ambassador, lieu du drame où quelques heures avant, se côtoient les partisans venu saluer le candidat à la présidence des USA, les clients de l’hôtel, les employés immigrés… Soit une vingtaine de personnages tous interprétés par un impressionnant casting de vedettes hollywoodiennes composé d’acteurs prestigieux, de jeunes talents ou d’anciennes stars déchues qui donnent vie à ce microcosme, reflet de l’Amérique des années 60 et de celle d’aujourd’hui, dont le réalisateur capte avec tact, les mêmes rêves, les mêmes espoirs et les mêmes frustrations (guerre du Viêtnam/guerre d’Irak, racisme, pauvreté)… Avec Bobby, Emilio Estevez passe avec succès derrière la caméra et livre un très beau film choral, démontrant qu’il est temps pour son pays d’adopter une autre politique au risque que les mêmes erreurs ne se répètent continuellement.
Plutôt que de réaliser un biopic fidèle et classique pour évoquer les dernières heures du sénateur Robert F. Kennedy, assassiné le 5 juin 1968, Emilio Estevez préfère s’intéresser aux anonymes. En l’occurrence ceux de l’hôtel Ambassador, lieu du drame où quelques heures avant, se côtoient les partisans venu saluer le candidat à la présidence des USA, les clients de l’hôtel, les employés immigrés… Soit une vingtaine de personnages tous interprétés par un impressionnant casting de vedettes hollywoodiennes composé d’acteurs prestigieux, de jeunes talents ou d’anciennes stars déchues qui donnent vie à ce microcosme, reflet de l’Amérique des années 60 et de celle d’aujourd’hui, dont le réalisateur capte avec tact, les mêmes rêves, les mêmes espoirs et les mêmes frustrations (guerre du Viêtnam/guerre d’Irak, racisme, pauvreté)… Avec Bobby, Emilio Estevez passe avec succès derrière la caméra et livre un très beau film choral, démontrant qu’il est temps pour son pays d’adopter une autre politique au risque que les mêmes erreurs ne se répètent continuellement. Il est évident que le dernier bébé de William Friedkin ne va pas plaire à tout le monde et c’est tant mieux ! Adaptation d’une pièce underground, Bug est un huit-clos minimaliste (1 décor, 5 personnages) mettant en scène deux êtres, deux loosers brisés par la vie qui vont s’unir à travers la paranoïa pour aller jusqu’à l’autodestruction. Un postulat de départ pas franchement attractif pour le spectateur lambda qui, s’il veut apprécier toute la richesse du film, se voit dans l’obligation d’accepter sans conditions les partis pris artistiques déstabilisants de l’œuvre, caractérisée par son absence totale d’explication. Car la vraie force du film est de maintenir le doute chez le spectateur, quant à la folie de ses protagonistes, sans jamais donner la moindre réponse réconfortante et cela même après le dernier plan. Certains crieront à la fumisterie mais ce serait trop vite juger ce thriller atypique, un peu long à entrer dans le vif du sujet et pas aussi angoissant qu’on l’aurait espéré, mais parsemé de soudains moments de brutalité et allant crescendo dans la claustrophobie. A voir une seconde fois.
Il est évident que le dernier bébé de William Friedkin ne va pas plaire à tout le monde et c’est tant mieux ! Adaptation d’une pièce underground, Bug est un huit-clos minimaliste (1 décor, 5 personnages) mettant en scène deux êtres, deux loosers brisés par la vie qui vont s’unir à travers la paranoïa pour aller jusqu’à l’autodestruction. Un postulat de départ pas franchement attractif pour le spectateur lambda qui, s’il veut apprécier toute la richesse du film, se voit dans l’obligation d’accepter sans conditions les partis pris artistiques déstabilisants de l’œuvre, caractérisée par son absence totale d’explication. Car la vraie force du film est de maintenir le doute chez le spectateur, quant à la folie de ses protagonistes, sans jamais donner la moindre réponse réconfortante et cela même après le dernier plan. Certains crieront à la fumisterie mais ce serait trop vite juger ce thriller atypique, un peu long à entrer dans le vif du sujet et pas aussi angoissant qu’on l’aurait espéré, mais parsemé de soudains moments de brutalité et allant crescendo dans la claustrophobie. A voir une seconde fois. Joel Schumacher est un réalisateur inégal, capable quelques fois du meilleur (Tideland, Chute libre, Phone Game) mais surtout du pire (Batman & Robin, Bad Company, Personne n’est parfait(e)), et son dernier film se situe une fois de plus dans la seconde catégorie. Pourtant il y avait matière à livrer un excellent thriller fantastique avec cette histoire de malédiction autour du nombre 23. Au lieu de jouer la carte de l’ambivalence (le héros perd t-il la boule ou est-il victime d’une malédiction ?) le script choisit très vite sa voie, abandonnant sur le bas côté son potentiel mystique. Reste alors un banal thriller, bien que complexe parfaitement invraisemblable et ridicule, à la fin moralisatrice et nous réservant tout un lot de retournement de situations déjà vu mille fois ces dernières années (merci Fenêtre Secrète, Fight Club et consort). Jim Carrey a l’air d’y croire à fond, tant mieux pour lui car difficile pour nous d’avaler cette baudruche se dégonflant dès le premier quart d’heure, mais qui demeure néanmoins un excellent exercice de calcul mental. C’est déjà ça !
Joel Schumacher est un réalisateur inégal, capable quelques fois du meilleur (Tideland, Chute libre, Phone Game) mais surtout du pire (Batman & Robin, Bad Company, Personne n’est parfait(e)), et son dernier film se situe une fois de plus dans la seconde catégorie. Pourtant il y avait matière à livrer un excellent thriller fantastique avec cette histoire de malédiction autour du nombre 23. Au lieu de jouer la carte de l’ambivalence (le héros perd t-il la boule ou est-il victime d’une malédiction ?) le script choisit très vite sa voie, abandonnant sur le bas côté son potentiel mystique. Reste alors un banal thriller, bien que complexe parfaitement invraisemblable et ridicule, à la fin moralisatrice et nous réservant tout un lot de retournement de situations déjà vu mille fois ces dernières années (merci Fenêtre Secrète, Fight Club et consort). Jim Carrey a l’air d’y croire à fond, tant mieux pour lui car difficile pour nous d’avaler cette baudruche se dégonflant dès le premier quart d’heure, mais qui demeure néanmoins un excellent exercice de calcul mental. C’est déjà ça ! Un film de Mark Neveldine et Brian Taylor
Un film de Mark Neveldine et Brian Taylor Le chemin de croix qu’endure le personnage principal d’Hyper Tension peut se voir comme le reflet de notre société moderne. Un monde qui oblige les êtres le constituant, à vivre à 100 à l’heure sans qu’ils puissent prendre le temps de vivre pleinement leurs existences et profiter de ce qui est vraiment important…Non je déconne ! En fait cette petite analyse j’aurais pu la faire si le film cherchait vraiment à raconter quelque chose, si les réalisateurs avaient des pensées ou une quelconque opinion à exprimer. Car ne cherchez pas d’histoire dans Hyper Tension il n’y en a pas, tout juste un pitch original et fun (un homme empoisonné doit sans cesse maintenir élevé son taux d’adrénaline pour retarder sa mort afin de trouver un remède) mais clairement limité. Difficile en effet de construire un vrai scénario qui réussisse à maintenir l’attention du spectateur juste avec un point départ aussi mince, même si la durée du film n’excède pas l’heure et demi. Un manque d’ambition flagrant qui s’explique par le fait que les deux réalisateurs (également scénaristes) conscients de leur manque d’idées originales, ont fait le choix de se passer de scénario digne de ce nom pour tout miser sur l’action.
Le chemin de croix qu’endure le personnage principal d’Hyper Tension peut se voir comme le reflet de notre société moderne. Un monde qui oblige les êtres le constituant, à vivre à 100 à l’heure sans qu’ils puissent prendre le temps de vivre pleinement leurs existences et profiter de ce qui est vraiment important…Non je déconne ! En fait cette petite analyse j’aurais pu la faire si le film cherchait vraiment à raconter quelque chose, si les réalisateurs avaient des pensées ou une quelconque opinion à exprimer. Car ne cherchez pas d’histoire dans Hyper Tension il n’y en a pas, tout juste un pitch original et fun (un homme empoisonné doit sans cesse maintenir élevé son taux d’adrénaline pour retarder sa mort afin de trouver un remède) mais clairement limité. Difficile en effet de construire un vrai scénario qui réussisse à maintenir l’attention du spectateur juste avec un point départ aussi mince, même si la durée du film n’excède pas l’heure et demi. Un manque d’ambition flagrant qui s’explique par le fait que les deux réalisateurs (également scénaristes) conscients de leur manque d’idées originales, ont fait le choix de se passer de scénario digne de ce nom pour tout miser sur l’action.  Et de l’action le film n’en manque pas, on peut même dire que ça ne s’arrête jamais. Calqué sur un modèle d’action non-stop, ayant déjà fait ses preuves dans Speed (le poison dans les veines remplace la bombe dans le bus) notre joli duo de metteurs en scène tournent comme s’ils étaient sous l’emprise de multiples drogues, utilisant à outrance tous les effets de clips possibles et imaginables, tendance MTV (accélérés, arrêt sur image, caméra quasi toujours en mouvement, montage sur découpé…). La saturation d’effets lourdingues est indéniable mais bizarrement ça marche. Certainement parce que la démarche, proche de celle d’un Tony Scott (même si le film est loin d’avoir l’intelligence et la pertinence de ceux du bonhomme), dynamise le rythme et insuffle au film une énergie peu commune, qui s’essouffle malgré tout au bout d’une heure. La faute à l’introduction du personnage inutile de la copine du héros dans la seconde partie. Caricature de la fille jolie mais pas fute-fute, elle n’est juste là que pour satisfaire avec entrain les bas instincts de son copain (la scène de fellation pendant une course poursuite). Pas sûr que les chiennes de gardes apprécient l’image de la femme véhiculée et pour le coup on ne peut pas leur donner tort. En tentant de provoquer en vain une émotion vis-à-vis de l’histoire d’amour du couple, le film ralentit son rythme jusque-là endiablé pour finir par lasser.
Et de l’action le film n’en manque pas, on peut même dire que ça ne s’arrête jamais. Calqué sur un modèle d’action non-stop, ayant déjà fait ses preuves dans Speed (le poison dans les veines remplace la bombe dans le bus) notre joli duo de metteurs en scène tournent comme s’ils étaient sous l’emprise de multiples drogues, utilisant à outrance tous les effets de clips possibles et imaginables, tendance MTV (accélérés, arrêt sur image, caméra quasi toujours en mouvement, montage sur découpé…). La saturation d’effets lourdingues est indéniable mais bizarrement ça marche. Certainement parce que la démarche, proche de celle d’un Tony Scott (même si le film est loin d’avoir l’intelligence et la pertinence de ceux du bonhomme), dynamise le rythme et insuffle au film une énergie peu commune, qui s’essouffle malgré tout au bout d’une heure. La faute à l’introduction du personnage inutile de la copine du héros dans la seconde partie. Caricature de la fille jolie mais pas fute-fute, elle n’est juste là que pour satisfaire avec entrain les bas instincts de son copain (la scène de fellation pendant une course poursuite). Pas sûr que les chiennes de gardes apprécient l’image de la femme véhiculée et pour le coup on ne peut pas leur donner tort. En tentant de provoquer en vain une émotion vis-à-vis de l’histoire d’amour du couple, le film ralentit son rythme jusque-là endiablé pour finir par lasser.  Mais là où Hyper Tension est particulier et fendard c’est dans sa subversion de la bonne morale américaine : fortement inspiré par les jeux vidéos, le film peut se voir comme l’adaptation de la série ultra populaire des Grand Thief Auto, dans lequel le joueur incarne un criminel, est libre d’errer dans la ville et de commettre toutes sortes de délits (meurtres, vols, tabassage, conduite dangereuse…) de manière complètement gratuite. Ainsi dans Hyper Tension, le héros commet toute une série de crimes comme rouler en voiture en plein centre commercial, voler la moto d’un flic, faire un casse dans la pharmacie d’un hôpital, sans se poser des questions existentielles ou encore prendre sa copine en levrette en pleine rue lorsque son niveau d’adrénaline baisse (il faut le voir pour le croire !). Alors qu’on pensait se retrouver face à un produit formaté, c’est un nanar complètement dingue, à la violence décomplexée et à l’humour noir du plus mauvais goût qui se déroule devant nos yeux. Véritable fer de lance d’un nouveau cinéma d’action décérébré et macho à prendre au 1000ème degré tant le film révèle de la farce dévastatrice, pire qu’un gremlins lâché dans un magasin de porcelaine ! On a le droit d’aimer seulement si l’on est conscient de la bêtise de l’entreprise.
Mais là où Hyper Tension est particulier et fendard c’est dans sa subversion de la bonne morale américaine : fortement inspiré par les jeux vidéos, le film peut se voir comme l’adaptation de la série ultra populaire des Grand Thief Auto, dans lequel le joueur incarne un criminel, est libre d’errer dans la ville et de commettre toutes sortes de délits (meurtres, vols, tabassage, conduite dangereuse…) de manière complètement gratuite. Ainsi dans Hyper Tension, le héros commet toute une série de crimes comme rouler en voiture en plein centre commercial, voler la moto d’un flic, faire un casse dans la pharmacie d’un hôpital, sans se poser des questions existentielles ou encore prendre sa copine en levrette en pleine rue lorsque son niveau d’adrénaline baisse (il faut le voir pour le croire !). Alors qu’on pensait se retrouver face à un produit formaté, c’est un nanar complètement dingue, à la violence décomplexée et à l’humour noir du plus mauvais goût qui se déroule devant nos yeux. Véritable fer de lance d’un nouveau cinéma d’action décérébré et macho à prendre au 1000ème degré tant le film révèle de la farce dévastatrice, pire qu’un gremlins lâché dans un magasin de porcelaine ! On a le droit d’aimer seulement si l’on est conscient de la bêtise de l’entreprise.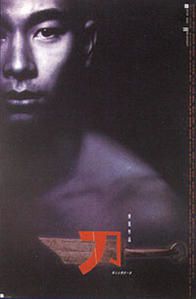 Un film de Tsui Hark
Un film de Tsui Hark
 Etant donc lassé du wu xia pan traditionnel avec ses combats aux chorégraphies câblées et fluides, à la mise en scène stylisée (je pense en particulier au raffinement des films de Chu Yan), Tsui Hark va adopter une ligne directrice complètement différente de ce qui se fait à l’époque et qu’il appellera l’ « action-vérité ». Premièrement et contrairement aux autres œuvres du genre se situant dans la Chine ancestrale, l’époque de l’histoire n’est pas définissable, aucuns repères temporels n’étant là pour nous aider, les évènements pouvant très bien se dérouler dans un futur apocalyptique à la Mad Max, à tel point qu’on aurait pas été surpris de voir une carcasse de voiture ou les ruines d’un immeuble dans les arrières plans. Deuxièmement il souhaite un cinéma d’action emprunt de réalisme, qui se rapproche le plus d’une certaine crédibilité, d’une vérité qui se traduit à travers sa mise en scène. Pour cela, il favorise l’improvisation dans chaque angle de la création : que ce soit dans le scénario qu’il prive de tout dialogue (le réalisateur écrira au jour le jour quelques dialogues directifs qui imposeront aux acteurs la lourde tâche d’improviser tout le long du tournage), l’absence de points de repères positionnels pour les comédiens obligeant le cadreur à être réactif à leur jeu, ou encore les scènes de combats dont les prouesses martiales, sans câbles, sont exécutées par les acteurs… Une approche révolutionnaire dans la manière d’aborder le cinéma d’action (qu'il réappliquera au polar dans Time & Tide), pas si éloigné de celle du « cinéma vérité » d’une certaine Nouvelle Vague française. Il est d’ailleurs amusant de remarquer que pratiquement au même moment, un autre réalisateur de film d’action, appliquera des principes semblables. En effet, John Mctiernan n’a-t-il pas réalisé Une Journée en Enfer avec ses scènes d’explosions et de poursuites, tournées dans les rues de New York en plein jour ? Un détail intéressant qui permet de faire un rapprochement entre les deux hommes. Mais ce n’est pas le sujet.
Etant donc lassé du wu xia pan traditionnel avec ses combats aux chorégraphies câblées et fluides, à la mise en scène stylisée (je pense en particulier au raffinement des films de Chu Yan), Tsui Hark va adopter une ligne directrice complètement différente de ce qui se fait à l’époque et qu’il appellera l’ « action-vérité ». Premièrement et contrairement aux autres œuvres du genre se situant dans la Chine ancestrale, l’époque de l’histoire n’est pas définissable, aucuns repères temporels n’étant là pour nous aider, les évènements pouvant très bien se dérouler dans un futur apocalyptique à la Mad Max, à tel point qu’on aurait pas été surpris de voir une carcasse de voiture ou les ruines d’un immeuble dans les arrières plans. Deuxièmement il souhaite un cinéma d’action emprunt de réalisme, qui se rapproche le plus d’une certaine crédibilité, d’une vérité qui se traduit à travers sa mise en scène. Pour cela, il favorise l’improvisation dans chaque angle de la création : que ce soit dans le scénario qu’il prive de tout dialogue (le réalisateur écrira au jour le jour quelques dialogues directifs qui imposeront aux acteurs la lourde tâche d’improviser tout le long du tournage), l’absence de points de repères positionnels pour les comédiens obligeant le cadreur à être réactif à leur jeu, ou encore les scènes de combats dont les prouesses martiales, sans câbles, sont exécutées par les acteurs… Une approche révolutionnaire dans la manière d’aborder le cinéma d’action (qu'il réappliquera au polar dans Time & Tide), pas si éloigné de celle du « cinéma vérité » d’une certaine Nouvelle Vague française. Il est d’ailleurs amusant de remarquer que pratiquement au même moment, un autre réalisateur de film d’action, appliquera des principes semblables. En effet, John Mctiernan n’a-t-il pas réalisé Une Journée en Enfer avec ses scènes d’explosions et de poursuites, tournées dans les rues de New York en plein jour ? Un détail intéressant qui permet de faire un rapprochement entre les deux hommes. Mais ce n’est pas le sujet. 


 Un film de Johnnie To
Un film de Johnnie To La presse avait trop vite fait d’enterrer le cinéma de Hong Kong qui connut un déclin durant la seconde moitié des années 90 et plus particulièrement le polar, genre phare de l’ex-colonie depuis Le syndicat du crime de John Woo. Et ce malgré les brillants coups de maîtres que furent Time & Tide de Tsui Hark (2001) et Infernals Affairs d’Andrew Lau (2002). Pas grave puisque Johnnie To avec son Breaking News en rajoute une nouvelle couche et démontre de manière définitive que le cinéma issu de la péninsule n’est pas mort. Comme le prouve la sélection du film au Festival de Cannes de 2004 (hors compétition) qui sonne comme une reconnaissance pour son réalisateur Johnnie To. Celle d’un homme qui a débuté sa carrière comme simple artisan pour devenir petit à petit un auteur à part entière et un grand cinéaste. Et quel meilleur choix que de présenter cette œuvre se situant entre cinéma grand public et cinéma d’auteur. Car même si Breaking News est loin d’être le film le plus personnel de son réalisateur, il n’en demeure pas moins qu’il reste l’un de ses plus virtuoses, riches et intelligents. L’un de ses meilleurs quoi.
La presse avait trop vite fait d’enterrer le cinéma de Hong Kong qui connut un déclin durant la seconde moitié des années 90 et plus particulièrement le polar, genre phare de l’ex-colonie depuis Le syndicat du crime de John Woo. Et ce malgré les brillants coups de maîtres que furent Time & Tide de Tsui Hark (2001) et Infernals Affairs d’Andrew Lau (2002). Pas grave puisque Johnnie To avec son Breaking News en rajoute une nouvelle couche et démontre de manière définitive que le cinéma issu de la péninsule n’est pas mort. Comme le prouve la sélection du film au Festival de Cannes de 2004 (hors compétition) qui sonne comme une reconnaissance pour son réalisateur Johnnie To. Celle d’un homme qui a débuté sa carrière comme simple artisan pour devenir petit à petit un auteur à part entière et un grand cinéaste. Et quel meilleur choix que de présenter cette œuvre se situant entre cinéma grand public et cinéma d’auteur. Car même si Breaking News est loin d’être le film le plus personnel de son réalisateur, il n’en demeure pas moins qu’il reste l’un de ses plus virtuoses, riches et intelligents. L’un de ses meilleurs quoi. Difficile de parler du film sans commencer par la fusillade qui ouvre le film et dont la presse a plus que parlée, occultant le reste du film : tournée en extérieur, en un seul plan séquence de 8 minutes (il n’y a aucunes coupures) et d’une grande fluidité dans ses mouvements, elle est l’une des plus époustouflantes que l’on a jamais vues. Un grand gun-flight qui mérite sa place dans les annales. Cette scène à elle seule témoigne que le cinéma hongkongais a toujours été celui de l’innovation en termes de mise en scène et d’action. Mais limiter Breaking News juste à cet unique plan c’est passer à côté d’un ébouriffant polar d’action certes moins créatif par la suite dans sa réalisation mais qui restera comme un modèle du genre rien que par son sujet.
Difficile de parler du film sans commencer par la fusillade qui ouvre le film et dont la presse a plus que parlée, occultant le reste du film : tournée en extérieur, en un seul plan séquence de 8 minutes (il n’y a aucunes coupures) et d’une grande fluidité dans ses mouvements, elle est l’une des plus époustouflantes que l’on a jamais vues. Un grand gun-flight qui mérite sa place dans les annales. Cette scène à elle seule témoigne que le cinéma hongkongais a toujours été celui de l’innovation en termes de mise en scène et d’action. Mais limiter Breaking News juste à cet unique plan c’est passer à côté d’un ébouriffant polar d’action certes moins créatif par la suite dans sa réalisation mais qui restera comme un modèle du genre rien que par son sujet. Même si le film est généreux en action et qu’il apparaît comme un film populaire, Breaking News cache une vraie critique du gouvernement chinois et plus généralement de la propagande qu’exercent les puissances en manipulant les médias. Par le contrôle des images, le sensationnalisme et la spectacularisation des faits, les autorités peuvent influencer l’opinion publique en détournant son attention des vrais problèmes de société. Divertir pour mieux abrutir les masses. Et tout les moyens sont bons pour se faire aimer du public : faire venir des vedettes du show business pour apporter leur soutien moral à la police, diffuser des interviews (voyeuristes) de parents de victimes mortes en service ou bien faire passer un flic lâche pour un héros ayant fait le choix de vivre pour subvenir aux besoins de sa famille… Des petites scènes satiriques qui montrent avec justesse la différence entre les évènements qui se déroulent dans l’immeuble et la réception faussée qu’ont des journalistes mis à l’écart. De la sorte le réalisateur porte un regard lucide et pertinent sur le caractère dangereux de l’information en direct mais aussi sur le fait que la manipulation des médias est une arme à double tranchant. Si les gouvernements nous manipulent grâce à l’information pourquoi ne pouvons-nous pas faire de même ? Si la police le fait pourquoi pas les gangsters ? Ainsi en plus d’une guerre par les armes à feu, la confrontation des deux clans devient une guerre des images où les flingues laissent la place aux dernières technologies de l’information (internet, téléphone portable muni d’appareil photo). Il est cependant dommage que le scénario utilise très peu l’idée que les policiers soient munis de petites caméras, cela aurait pu donner quelque chose d’intéressant. Mais en l’état la critique est pertinente, jamais sous-traitée au profit de l’action et le scénario ne cède jamais au manichéisme.
Même si le film est généreux en action et qu’il apparaît comme un film populaire, Breaking News cache une vraie critique du gouvernement chinois et plus généralement de la propagande qu’exercent les puissances en manipulant les médias. Par le contrôle des images, le sensationnalisme et la spectacularisation des faits, les autorités peuvent influencer l’opinion publique en détournant son attention des vrais problèmes de société. Divertir pour mieux abrutir les masses. Et tout les moyens sont bons pour se faire aimer du public : faire venir des vedettes du show business pour apporter leur soutien moral à la police, diffuser des interviews (voyeuristes) de parents de victimes mortes en service ou bien faire passer un flic lâche pour un héros ayant fait le choix de vivre pour subvenir aux besoins de sa famille… Des petites scènes satiriques qui montrent avec justesse la différence entre les évènements qui se déroulent dans l’immeuble et la réception faussée qu’ont des journalistes mis à l’écart. De la sorte le réalisateur porte un regard lucide et pertinent sur le caractère dangereux de l’information en direct mais aussi sur le fait que la manipulation des médias est une arme à double tranchant. Si les gouvernements nous manipulent grâce à l’information pourquoi ne pouvons-nous pas faire de même ? Si la police le fait pourquoi pas les gangsters ? Ainsi en plus d’une guerre par les armes à feu, la confrontation des deux clans devient une guerre des images où les flingues laissent la place aux dernières technologies de l’information (internet, téléphone portable muni d’appareil photo). Il est cependant dommage que le scénario utilise très peu l’idée que les policiers soient munis de petites caméras, cela aurait pu donner quelque chose d’intéressant. Mais en l’état la critique est pertinente, jamais sous-traitée au profit de l’action et le scénario ne cède jamais au manichéisme.  En insistant sur le côté manipulateur des autorités, le film brouille la frontière entre les « gentils » et les « méchants ». La police dont la figure de proue est l’inspecteur Rebecca (Kelly Chen qui montre très vite les limites de son jeu) ne trouve pas grâce auprès du spectateur alors que les gangsters deviennent des personnages sympathiques même si l’on ignore presque tous d’eux. Ce qui démontre une fois de plus la grande capacité de Johnnie To pour brosser en quelques traits des personnages forts et marquants. Des personnages qui sont au cœur d’un scénario malin au rythme sans faille (le film rend très bien le sentiment d’urgence), qui ne cesse de surprendre et de prendre des directions parfois inattendues (la scène du repas, la brève complicité dans la cage d’ascenseur entre le flic et les truands, l’histoire d’amour entre l’inspecteur Rebecca et le chef de la bande…) tout en maniant habilement un humour léger jamais plombant. Splendide dans sa forme, intelligent dans le fond, à la fois drôle et tragique, spectaculaire et intimiste. Qui a dit que le cinéma de Hong Kong était mort ?
En insistant sur le côté manipulateur des autorités, le film brouille la frontière entre les « gentils » et les « méchants ». La police dont la figure de proue est l’inspecteur Rebecca (Kelly Chen qui montre très vite les limites de son jeu) ne trouve pas grâce auprès du spectateur alors que les gangsters deviennent des personnages sympathiques même si l’on ignore presque tous d’eux. Ce qui démontre une fois de plus la grande capacité de Johnnie To pour brosser en quelques traits des personnages forts et marquants. Des personnages qui sont au cœur d’un scénario malin au rythme sans faille (le film rend très bien le sentiment d’urgence), qui ne cesse de surprendre et de prendre des directions parfois inattendues (la scène du repas, la brève complicité dans la cage d’ascenseur entre le flic et les truands, l’histoire d’amour entre l’inspecteur Rebecca et le chef de la bande…) tout en maniant habilement un humour léger jamais plombant. Splendide dans sa forme, intelligent dans le fond, à la fois drôle et tragique, spectaculaire et intimiste. Qui a dit que le cinéma de Hong Kong était mort ? Un film de Franck Mancuso
Un film de Franck Mancuso




 Harold, agent du fisc, vit une existence morne et solitaire dans un appartement qu’on croirait sorti du catalogue d’un magasin pour meubles. Sa seule distraction est d’écouter le bruit des dossiers qu’il range. Alors quand il se met à entendre une voix qui narre le moindre de ses gestes, Harold croit devenir fou. En fait il découvre qu’il est le personnage principal vivant du dernier livre d’une romancière qui a la fâcheuse habitude de zigouiller ses héros. Une découverte qui va le pousser à vivre pleinement les derniers instants de sa vie. Réalisé par l’éclectique Marc Foster, L’incroyable… est une comédie réjouissante au scénario original, réflexion sur le travail d’écrivain et ode à l’accomplissement personnel dont le message pourrait se résumer simplement par « Carpe Diem ». Emporté par un Will Ferrell (plus habitué aux comédies grasses et lourdingues) étonnant de sobriété et une Maggie Gyllenhaal craquante, le film fait partie des meilleures comédies qui émeuvent tout en faisant rire.
Harold, agent du fisc, vit une existence morne et solitaire dans un appartement qu’on croirait sorti du catalogue d’un magasin pour meubles. Sa seule distraction est d’écouter le bruit des dossiers qu’il range. Alors quand il se met à entendre une voix qui narre le moindre de ses gestes, Harold croit devenir fou. En fait il découvre qu’il est le personnage principal vivant du dernier livre d’une romancière qui a la fâcheuse habitude de zigouiller ses héros. Une découverte qui va le pousser à vivre pleinement les derniers instants de sa vie. Réalisé par l’éclectique Marc Foster, L’incroyable… est une comédie réjouissante au scénario original, réflexion sur le travail d’écrivain et ode à l’accomplissement personnel dont le message pourrait se résumer simplement par « Carpe Diem ». Emporté par un Will Ferrell (plus habitué aux comédies grasses et lourdingues) étonnant de sobriété et une Maggie Gyllenhaal craquante, le film fait partie des meilleures comédies qui émeuvent tout en faisant rire.
 Débutons par le point le plus mis en avant par la grande campagne publicitaire du film, à savoir la prestation de Marion Cotillard dans la peau du moineau vêtu de noir. Tout le monde est d’accord (et je peux difficilement contredire) pour dire qu’elle est absolument merveilleuse en Piaf. Aidée par un maquillage voyant mais jamais envahissant, l’actrice fait preuve d’un mimétisme parfait (comme Jamie Foxx avec Ray Charles dans Ray), que ce soit lorsqu’elle incarne Piaf en jeune fille de la rue ou dans les dernières heures de sa vie, le spectateur assiste à une résurrection de la chanteuse. Marion Cotillard ne joue pas, elle est Piaf ! Une performance qui était nécessaire à la réussite émotionnelle du projet, le personnage étant le cœur même du film.
Débutons par le point le plus mis en avant par la grande campagne publicitaire du film, à savoir la prestation de Marion Cotillard dans la peau du moineau vêtu de noir. Tout le monde est d’accord (et je peux difficilement contredire) pour dire qu’elle est absolument merveilleuse en Piaf. Aidée par un maquillage voyant mais jamais envahissant, l’actrice fait preuve d’un mimétisme parfait (comme Jamie Foxx avec Ray Charles dans Ray), que ce soit lorsqu’elle incarne Piaf en jeune fille de la rue ou dans les dernières heures de sa vie, le spectateur assiste à une résurrection de la chanteuse. Marion Cotillard ne joue pas, elle est Piaf ! Une performance qui était nécessaire à la réussite émotionnelle du projet, le personnage étant le cœur même du film.  Du point de vue scénaristique peu de surprises. Toutes les étapes importantes de l’existence de l’artiste sont là, rien ne manque. De son enfance difficile, ses débuts, sa gloire, l’annonce de la mort de son amant Marcel Cerdan (la meilleure scène du film !!!), jusqu’à sa mort, vous serez tout de la vie d’Edith Piaf. Si Olivier Dahan a choisit d’éviter une narration linéaire (le récit navigue sans cesse entre différentes périodes) évitant d’être trop classique dans sa forme, le film n’apporte pas grand-chose au genre de la biographie de célébrités. Car le réalisateur n’a pas fait le choix de faire un film « d’auteur » dans lequel il aurait insufflé sa propre vision de la vie de Piaf, mais celui d’offrir un film à dimension populaire.
Du point de vue scénaristique peu de surprises. Toutes les étapes importantes de l’existence de l’artiste sont là, rien ne manque. De son enfance difficile, ses débuts, sa gloire, l’annonce de la mort de son amant Marcel Cerdan (la meilleure scène du film !!!), jusqu’à sa mort, vous serez tout de la vie d’Edith Piaf. Si Olivier Dahan a choisit d’éviter une narration linéaire (le récit navigue sans cesse entre différentes périodes) évitant d’être trop classique dans sa forme, le film n’apporte pas grand-chose au genre de la biographie de célébrités. Car le réalisateur n’a pas fait le choix de faire un film « d’auteur » dans lequel il aurait insufflé sa propre vision de la vie de Piaf, mais celui d’offrir un film à dimension populaire.  Comme l’évoque l’affiche du film (où l’on voit l’actrice de dos face à la foule éclairée) et son casting prestigieux de guest-stars françaises, La Môme est une œuvre faite pour le public, qui s’adresse directement à lui. En faisant cela Olivier Dahan fait exactement ce que fît Piaf à son époque : elle s’offrait à son public, elle chantait pour lui et même si cela devait lui coûter la vie. En offrant aux spectateurs ce qu’il est venu voir, c'est-à-dire un portrait fidèle, émouvant et tragique (sans toutefois verser dans le misérabilisme), Dahan restitue l’âme d’Edith Piaf, sa philosophie et tout ce qu’elle représentait. Et c’est peut être le plus bel hommage qu’on pouvait lui faire.
Comme l’évoque l’affiche du film (où l’on voit l’actrice de dos face à la foule éclairée) et son casting prestigieux de guest-stars françaises, La Môme est une œuvre faite pour le public, qui s’adresse directement à lui. En faisant cela Olivier Dahan fait exactement ce que fît Piaf à son époque : elle s’offrait à son public, elle chantait pour lui et même si cela devait lui coûter la vie. En offrant aux spectateurs ce qu’il est venu voir, c'est-à-dire un portrait fidèle, émouvant et tragique (sans toutefois verser dans le misérabilisme), Dahan restitue l’âme d’Edith Piaf, sa philosophie et tout ce qu’elle représentait. Et c’est peut être le plus bel hommage qu’on pouvait lui faire.  Un film de David Lynch
Un film de David Lynch Tout le monde dit c’est génial
Tout le monde dit c’est génial L’empire des sens
L’empire des sens Déjà Vu
Déjà Vu On est toujours mieux servi que par soit même…
On est toujours mieux servi que par soit même…