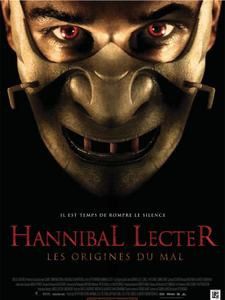 Un film de Peter Webber
Un film de Peter Webber


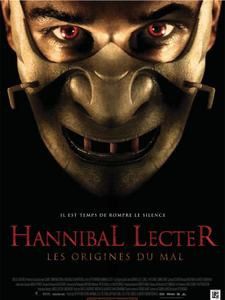 Un film de Peter Webber
Un film de Peter Webber


 Un film de Mel Gibson
Un film de Mel Gibson

 Running Man
Running Man Faut que ça saigne !
Faut que ça saigne ! This is the end…
This is the end… Un film de Jonathan Liebesman
Un film de Jonathan Liebesman 
 Les origines du mal
Les origines du mal Misère de misère.
Misère de misère. A l’ouest rien de nouveau
A l’ouest rien de nouveau Le bras ou la cuisse
Le bras ou la cuisse Un film de Frédéric Schoendoerffer
Un film de Frédéric Schoendoerffer Le but du film est clair : montrer avec le plus de réalisme possible le milieu du grand banditisme parisien. Tout comme son précédent film Agents Secrets qui proposait une vision anti-spectaculaire du monde des espions, Frédéric Schoendoerffer va conserver les mêmes qualités (l’aspect réaliste, la non-glorification des personnages…) mais aussi les même défauts. Le ton général du film est donné dès la première scène (l’une des plus réussie) qui voit le duo de tueurs à gages, campés par Benoît Magimel et Olivier Marchal, exécuté un contrat sans aucunes émotions, y compris pour une jeune femme ne pas censée être présente à ce moment là, et qui criera toute sa volonté de vivre avant d’être froidement abattue. Une entrée en matière brute, radicale et violente mais qui n’amènera à rien par la suite. Car si on peut difficilement reprocher les ambitions du réalisateur voulant à tout prix démystifier le monde des gangsters, un milieu qui a vite fait d’être idolâtré de nos jours, par toute une jeunesse élevée au visionnage du Scarface de Brian de Palma, ni voyant là que l’apologie du gangstérisme comme seul moyen d’accéder à l’argent facile, donc au pouvoir, donc à la reconnaissance sociale, donc au respect (ils n’ont rien compris du tout), on peut aisément critiquer le fait que tous les aspects les moins glamours montrés dans le film (règlements de comptes sanglants, de tortures, de sévices sexuel…) ainsi que la violence crue ne servent en rien le propos du réalisateur qui n’a pas juger bon d’inscrire tous ces éléments dans une intrigue digne de ce nom. Le scénario n’étant qu’une accumulation de scènes n’ayant le plus souvent aucun rapport entre elles (un semblant d’histoire ne prend forme que dans la seconde partie), d’où le manque crucial de véritables enjeux dramatiques. L’exemple le plus flagrant en est la fusillade sur le parking (très inspiré de celle de Heat), qui pouvait légitiment faire penser qu’elle serait le point de départ de l’intrigue mais dont la conclusion des enjeux va se faire deux scènes plus tard. Alors que nous sommes qu’au début du métrage ! Vouloir faire un film de gangster réaliste, proche du documentaire ne signifie pas qu’il faut en oublier les codes. Surtout que 36 quai des orfèvres avait su démontrer qu’on pouvait mélanger de façon cohérente pur film de genre et « cinéma vérité ».
Le but du film est clair : montrer avec le plus de réalisme possible le milieu du grand banditisme parisien. Tout comme son précédent film Agents Secrets qui proposait une vision anti-spectaculaire du monde des espions, Frédéric Schoendoerffer va conserver les mêmes qualités (l’aspect réaliste, la non-glorification des personnages…) mais aussi les même défauts. Le ton général du film est donné dès la première scène (l’une des plus réussie) qui voit le duo de tueurs à gages, campés par Benoît Magimel et Olivier Marchal, exécuté un contrat sans aucunes émotions, y compris pour une jeune femme ne pas censée être présente à ce moment là, et qui criera toute sa volonté de vivre avant d’être froidement abattue. Une entrée en matière brute, radicale et violente mais qui n’amènera à rien par la suite. Car si on peut difficilement reprocher les ambitions du réalisateur voulant à tout prix démystifier le monde des gangsters, un milieu qui a vite fait d’être idolâtré de nos jours, par toute une jeunesse élevée au visionnage du Scarface de Brian de Palma, ni voyant là que l’apologie du gangstérisme comme seul moyen d’accéder à l’argent facile, donc au pouvoir, donc à la reconnaissance sociale, donc au respect (ils n’ont rien compris du tout), on peut aisément critiquer le fait que tous les aspects les moins glamours montrés dans le film (règlements de comptes sanglants, de tortures, de sévices sexuel…) ainsi que la violence crue ne servent en rien le propos du réalisateur qui n’a pas juger bon d’inscrire tous ces éléments dans une intrigue digne de ce nom. Le scénario n’étant qu’une accumulation de scènes n’ayant le plus souvent aucun rapport entre elles (un semblant d’histoire ne prend forme que dans la seconde partie), d’où le manque crucial de véritables enjeux dramatiques. L’exemple le plus flagrant en est la fusillade sur le parking (très inspiré de celle de Heat), qui pouvait légitiment faire penser qu’elle serait le point de départ de l’intrigue mais dont la conclusion des enjeux va se faire deux scènes plus tard. Alors que nous sommes qu’au début du métrage ! Vouloir faire un film de gangster réaliste, proche du documentaire ne signifie pas qu’il faut en oublier les codes. Surtout que 36 quai des orfèvres avait su démontrer qu’on pouvait mélanger de façon cohérente pur film de genre et « cinéma vérité ».  Mais le défaut le plus visible reste l’épouvantable interprétation générale. Tellement mauvaise qu’elle gâche complètement à elle seule les quelques qualités qu’on pouvait trouver dans le film. Si le duo Benoît Magimel et Olivier Marchal fonctionne bien, leurs personnages n’ont pas la profondeur de ceux d’un film comme Heat dont Frédéric Schoendoerffer s’inspire beaucoup, pour ne pas utiliser le mot pomper (filmer Magimel devant des vitres scrutant l’horizon ne donne pas le génie d’un Michael Mann) et le personnage de Béatrice Dalle n’est pas assez présent à l’écran pour pardonner la contre-performance de Philippe Caubère en parrain de la pègre, sur jouant à tout bout champ, intensifiant à outrance chaque répliques jusqu’à en devenir comique (la scène de son pétage de plomb, un grand moment de drôlerie « on me beurre pas la raie moi ! »), au point que le réalisme tant vanter par l’équipe du film ne devient plus qu’une succession de caricature et de clichés. La faute à toute une palette de seconds rôles, qui selon eux, jouer des gangsters ne signifie qu’accumuler les insultes tous les quarts de secondes. A commencer par Ludovic Schoendoerffer (encore un pistonné tiens), incapable de balancer une seule réplique ou même un seul mot sans avoir l’air ridicule. A lui seul, il rend la vision du film franchement pénible à un tel point qu’on espère à chaque fois que son personnage va mourir (ce qui sera le cas mais malheureusement vers la fin). Les acteurs ne sont pas les seuls fautifs, il faut en incomber la responsabilité au réalisateur lui-même qui visiblement n’a pas trouver utile de fournir une direction d’acteur, préférant laisser tout son casting jouer en complète roue libre.
Mais le défaut le plus visible reste l’épouvantable interprétation générale. Tellement mauvaise qu’elle gâche complètement à elle seule les quelques qualités qu’on pouvait trouver dans le film. Si le duo Benoît Magimel et Olivier Marchal fonctionne bien, leurs personnages n’ont pas la profondeur de ceux d’un film comme Heat dont Frédéric Schoendoerffer s’inspire beaucoup, pour ne pas utiliser le mot pomper (filmer Magimel devant des vitres scrutant l’horizon ne donne pas le génie d’un Michael Mann) et le personnage de Béatrice Dalle n’est pas assez présent à l’écran pour pardonner la contre-performance de Philippe Caubère en parrain de la pègre, sur jouant à tout bout champ, intensifiant à outrance chaque répliques jusqu’à en devenir comique (la scène de son pétage de plomb, un grand moment de drôlerie « on me beurre pas la raie moi ! »), au point que le réalisme tant vanter par l’équipe du film ne devient plus qu’une succession de caricature et de clichés. La faute à toute une palette de seconds rôles, qui selon eux, jouer des gangsters ne signifie qu’accumuler les insultes tous les quarts de secondes. A commencer par Ludovic Schoendoerffer (encore un pistonné tiens), incapable de balancer une seule réplique ou même un seul mot sans avoir l’air ridicule. A lui seul, il rend la vision du film franchement pénible à un tel point qu’on espère à chaque fois que son personnage va mourir (ce qui sera le cas mais malheureusement vers la fin). Les acteurs ne sont pas les seuls fautifs, il faut en incomber la responsabilité au réalisateur lui-même qui visiblement n’a pas trouver utile de fournir une direction d’acteur, préférant laisser tout son casting jouer en complète roue libre.  Un film d’Edward Zwick
Un film d’Edward Zwick
 Surfant sur la récente vague des films politiques hollywoodien initié par The Constant Gardener, le nouveau film de l’assez inégal réalisateur Edward Zwick (Glory, Couvre Feu, Le dernier samouraï…) Blood Diamond prend le pari risqué de proposer une dénonciation du trafic de diamants de guerre (appelés diamants de sang) tout en prenant les traits d’un pur divertissement hollywoodien. Risqué car il y a de fortes chances que le spectacle prenne le dessus sur le message politique au point de le faire passer au second plan. Fort heureusement ce n’est pas totalement le cas ici.
Surfant sur la récente vague des films politiques hollywoodien initié par The Constant Gardener, le nouveau film de l’assez inégal réalisateur Edward Zwick (Glory, Couvre Feu, Le dernier samouraï…) Blood Diamond prend le pari risqué de proposer une dénonciation du trafic de diamants de guerre (appelés diamants de sang) tout en prenant les traits d’un pur divertissement hollywoodien. Risqué car il y a de fortes chances que le spectacle prenne le dessus sur le message politique au point de le faire passer au second plan. Fort heureusement ce n’est pas totalement le cas ici. x pour faire prendre conscience des ravages causés par le commerce illégal de la principale ressource du pays qui aurait dû l'aider à se développer au lieu de l’enfoncer un peu plus dans la misère la plus totale. Si on pouvait craindre un film consensuel de la part du réalisateur il n’en est rien : le film montre sans fard et avec réalisme toute l’horreur de la guerre et ses conséquences sur la population. Ainsi Edward Zwick ne nous épargne pas la violence des images de mains coupées par les rebelles (pour que la population ne puisse pas voter), sans toutefois verser dans le gore, ou bien celle d’enfants soldats abattant sans aucunes émotions des innocents. Des enfants dont toutes les étapes de l’initiation sont exposées aux yeux du spectateur (enlèvement, aliénation à coup de propagande, entraînement au tir sur des cibles vivantes, soumission par la drogue…). Même si les images ne sont pas les plus insoutenables elles n’en demeurent pas moins inhabituelles pour un blockbuster. Le film ne se prive pas non plus pour mettre en cause la responsabilité des gouvernements occidentaux et leur inaction quand ce n’est pas leur incapacité à aider le peuple africain (le personnage de Salomon qui se voit rétorquer par un membre d’une ONG « Que Dieu vous aide, moi je ne peux pas ») mais aussi celle des grandes sociétés capitalistes qui profitent de la guerre pour s’enrichir en stockant les pierres dans des banques pour faire croire à leur rareté et ainsi les vendre au prix le plus élevé. Une réalité franchement pas très jolie à regarder et qui étonne d’être dans un film au budget de 100 millions de dollars. Il faut croire que Hollywood y trouve son compte (financier évidemment) en produisant des films à conscience politique mais divertissant.
x pour faire prendre conscience des ravages causés par le commerce illégal de la principale ressource du pays qui aurait dû l'aider à se développer au lieu de l’enfoncer un peu plus dans la misère la plus totale. Si on pouvait craindre un film consensuel de la part du réalisateur il n’en est rien : le film montre sans fard et avec réalisme toute l’horreur de la guerre et ses conséquences sur la population. Ainsi Edward Zwick ne nous épargne pas la violence des images de mains coupées par les rebelles (pour que la population ne puisse pas voter), sans toutefois verser dans le gore, ou bien celle d’enfants soldats abattant sans aucunes émotions des innocents. Des enfants dont toutes les étapes de l’initiation sont exposées aux yeux du spectateur (enlèvement, aliénation à coup de propagande, entraînement au tir sur des cibles vivantes, soumission par la drogue…). Même si les images ne sont pas les plus insoutenables elles n’en demeurent pas moins inhabituelles pour un blockbuster. Le film ne se prive pas non plus pour mettre en cause la responsabilité des gouvernements occidentaux et leur inaction quand ce n’est pas leur incapacité à aider le peuple africain (le personnage de Salomon qui se voit rétorquer par un membre d’une ONG « Que Dieu vous aide, moi je ne peux pas ») mais aussi celle des grandes sociétés capitalistes qui profitent de la guerre pour s’enrichir en stockant les pierres dans des banques pour faire croire à leur rareté et ainsi les vendre au prix le plus élevé. Une réalité franchement pas très jolie à regarder et qui étonne d’être dans un film au budget de 100 millions de dollars. Il faut croire que Hollywood y trouve son compte (financier évidemment) en produisant des films à conscience politique mais divertissant. Comme je l’ai dit au tout début, le film est un divertissement hollywoodien qui se présente comme une chasse au trésor qui se présente sous la forme d’un diamant rose rarissime et gros comme le poing, qui va attiser la convoitise de tous ceux qui auront connaissance du dit objet. A partir d’un simple récit d’aventure, le réalisateur fait réfléchir le spectateur sur sa propre responsabilité face à ce problème (Cf. le texte à la fin du film) tout en lui offrant un spectacle avec son lot de courses poursuites, fusillades et autres explosions livrées à un rythme soutenu et de manière énergique. Un aspect spectacle qui s’harmonise très bien avec celui politique du film durant toute sa durée (excepté à la fin où le divertissement occupe toute la place) bien que ce soit le côté spectacle qui soit bizarrement le moins réussi : le déroulement de l’intrigue n’est pas nouveau et n’échappe pas aux facilités hollywoodiennes comme la rédemption de l’anti héros (interprété par un Leonardo DiCaprio qui gagne en maturité à chaque film), un mercenaire égoïste qui d’un coup effectue un virage à 180° à la toute fin. Ou alors le traitement un peu trop caricatural des personnages malgré les excellentes interprétations du trio d’acteurs. A commencer par Djimon Hounsou (ce mec n’a pas eu la carrière qu’il aurait dû avoir) représentant l’Afrique victime et innocente ou encore le personnage de journaliste de Jennifer Connelly (belle à mourir) qui représente l’occident en quête de vérité et de moralité dont le scénario ne semble pas trop savoir quoi en faire. Des défauts qui empêchent le film d’égaler la réussite de films comme Lord of War ou de The Constant Gardener, qui avait un sujet presque semblable. Mais en l’état Blood Diamond est un film efficace qui arrive sans peine à livrer son message (quelques fois de manière didactique) et c’est quand même ça le plus important.
Comme je l’ai dit au tout début, le film est un divertissement hollywoodien qui se présente comme une chasse au trésor qui se présente sous la forme d’un diamant rose rarissime et gros comme le poing, qui va attiser la convoitise de tous ceux qui auront connaissance du dit objet. A partir d’un simple récit d’aventure, le réalisateur fait réfléchir le spectateur sur sa propre responsabilité face à ce problème (Cf. le texte à la fin du film) tout en lui offrant un spectacle avec son lot de courses poursuites, fusillades et autres explosions livrées à un rythme soutenu et de manière énergique. Un aspect spectacle qui s’harmonise très bien avec celui politique du film durant toute sa durée (excepté à la fin où le divertissement occupe toute la place) bien que ce soit le côté spectacle qui soit bizarrement le moins réussi : le déroulement de l’intrigue n’est pas nouveau et n’échappe pas aux facilités hollywoodiennes comme la rédemption de l’anti héros (interprété par un Leonardo DiCaprio qui gagne en maturité à chaque film), un mercenaire égoïste qui d’un coup effectue un virage à 180° à la toute fin. Ou alors le traitement un peu trop caricatural des personnages malgré les excellentes interprétations du trio d’acteurs. A commencer par Djimon Hounsou (ce mec n’a pas eu la carrière qu’il aurait dû avoir) représentant l’Afrique victime et innocente ou encore le personnage de journaliste de Jennifer Connelly (belle à mourir) qui représente l’occident en quête de vérité et de moralité dont le scénario ne semble pas trop savoir quoi en faire. Des défauts qui empêchent le film d’égaler la réussite de films comme Lord of War ou de The Constant Gardener, qui avait un sujet presque semblable. Mais en l’état Blood Diamond est un film efficace qui arrive sans peine à livrer son message (quelques fois de manière didactique) et c’est quand même ça le plus important.
(Une affiche teaser que personnellement je trouve meilleure que l'affiche du film)
 Un film de Johnnie To
Un film de Johnnie To Un film de Johnnie To
Un film de Johnnie To
 Le départ de nombreux talents de Hong Kong pour Hollywood comme John Woo, Tsui Hark (heureusement revenu), Ringo Lam, Ronny Yu… nous ont fait oublier une chose importante : ils ne sont pas TOUS partis ! Et le cinéma de Hong Kong possède encore des réalisateurs passionnants. Johnnie To en est surement le plus bel exemple. Depuis déjà quelques années le réalisateur s’est fait un nom à Hong-Kong et tout récemment en occident (depuis The Mission en 2001) et connaît aussi bien les faveurs du public que celles de la critique. Une raison à cela : le bonhomme tourne beaucoup de films commerciaux comme des comédies romantiques dans l’ère du temps qui lui garantissent un succès financier pour pouvoir réaliser des œuvres plus personnelles, moins grand public. Une méthode qu’on peut critiquer certes mais qui a le mérite de lui permettre de trouver facilement des financements et d’avoir une totale liberté d’expression lorsqu’il livre un film dit d’auteur. Et ses deux derniers opus Election 1 et Election 2 sont de bons exemples de ça.
Le départ de nombreux talents de Hong Kong pour Hollywood comme John Woo, Tsui Hark (heureusement revenu), Ringo Lam, Ronny Yu… nous ont fait oublier une chose importante : ils ne sont pas TOUS partis ! Et le cinéma de Hong Kong possède encore des réalisateurs passionnants. Johnnie To en est surement le plus bel exemple. Depuis déjà quelques années le réalisateur s’est fait un nom à Hong-Kong et tout récemment en occident (depuis The Mission en 2001) et connaît aussi bien les faveurs du public que celles de la critique. Une raison à cela : le bonhomme tourne beaucoup de films commerciaux comme des comédies romantiques dans l’ère du temps qui lui garantissent un succès financier pour pouvoir réaliser des œuvres plus personnelles, moins grand public. Une méthode qu’on peut critiquer certes mais qui a le mérite de lui permettre de trouver facilement des financements et d’avoir une totale liberté d’expression lorsqu’il livre un film dit d’auteur. Et ses deux derniers opus Election 1 et Election 2 sont de bons exemples de ça. Bien que Election 1 & 2 appartiennent à un genre populaire (le film de gangster) qui devrait lui ouvrir les portes du box office c’est leur traitement qu’on pourrait presque qualifier de radical qui les rapprochent clairement du cinéma d’auteur. Sans atteindre le paroxysme de PTU, les deux films possèdent un rythme lent et posé qui contraste fortement avec ceux de films du même genre et qui dérouteront le spectateur lambda venu voir un pur divertissement rythmé et riche en scènes d’action démentielles. Chaque film comporte environ une seule grosse scène d’action (et encore elles ne sont jamais vraiment traitées comme telle) et ne combleront surement pas toutes les attentes (aucuns gun fight), un peu comme dans The Mission où les fusillades incroyablement statiques différaient de celles des standards asiatiques et dont les films de John Woo étaient la référence des années 90. Mais le fait que les films soient lents et avares en action pure ne veut pas dire qu’ils soient chiants et inintéressants. Bien au contraire.
Bien que Election 1 & 2 appartiennent à un genre populaire (le film de gangster) qui devrait lui ouvrir les portes du box office c’est leur traitement qu’on pourrait presque qualifier de radical qui les rapprochent clairement du cinéma d’auteur. Sans atteindre le paroxysme de PTU, les deux films possèdent un rythme lent et posé qui contraste fortement avec ceux de films du même genre et qui dérouteront le spectateur lambda venu voir un pur divertissement rythmé et riche en scènes d’action démentielles. Chaque film comporte environ une seule grosse scène d’action (et encore elles ne sont jamais vraiment traitées comme telle) et ne combleront surement pas toutes les attentes (aucuns gun fight), un peu comme dans The Mission où les fusillades incroyablement statiques différaient de celles des standards asiatiques et dont les films de John Woo étaient la référence des années 90. Mais le fait que les films soient lents et avares en action pure ne veut pas dire qu’ils soient chiants et inintéressants. Bien au contraire. A l’image romantique des gangsters, Johnnie To choisit une image beaucoup plus réaliste, froide, moins glamour du milieu des triades (on ne voit jamais leurs tatouages par exemple) faite à partir de recherches et d’interviews de véritables personnes issus de la mafia chinoise. Le réalisateur livre une histoire passionnante (on a toujours envie de savoir ce qu’il va se passer) sur le schéma typique du Rise & Fall (le premier opus montre l’ascension au pouvoir du personnage de Lok, le second sa chute) offrant son lot de meurtres, de règlements de comptes, de complots et de trahisons avec une violence omniprésente, crue et sèche collant parfaitement avec le ton général de l’ensemble mais qui n’empêche pas le réalisateur de se permettre d’utiliser à de rares occasions un humour noir ravageur (comme dans le premier volet où un des personnages reçoit l’ordre par téléphone de protéger un membre de son clan qu’il vient juste de tabasser furieusement croyant que c’était un opposant) donnant un petit peu de légèreté dans cette histoire (les deux films forment véritablement un tout) désespérément noire. Une noirceur due également à la mise en scène jouant beaucoup sur les clairs-obscurs et l’absence de personnages positifs. Car si on peut prendre le parti de Lok dans le premier film, son acte à la fin (il tue son rival par traîtrise et la femme de celui-ci devant les yeux de son enfant) nous le rend beaucoup moins sympathique, enfonçant définitivement l’image cinématographique héroïque des mafieux. Non, il n’y a pas de héros dans les triades juste des traitres avides de pouvoir, un pouvoir auquel on ne peut accéder que par la voie de la violence et du sang, de la corruption et de la dictature : l’action se situe en 1997, c'est-à-dire lors de la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Ainsi Johnnie To cache à peine son inquiétude pour sa ville laissée au gouvernement chinois comme à travers le personnage de Jimmy voulant redevenir honnête mais qui devient prisonnier d’un système dont il ne pourra pas s’échapper. Pessimiste mais encore une fois réaliste.
A l’image romantique des gangsters, Johnnie To choisit une image beaucoup plus réaliste, froide, moins glamour du milieu des triades (on ne voit jamais leurs tatouages par exemple) faite à partir de recherches et d’interviews de véritables personnes issus de la mafia chinoise. Le réalisateur livre une histoire passionnante (on a toujours envie de savoir ce qu’il va se passer) sur le schéma typique du Rise & Fall (le premier opus montre l’ascension au pouvoir du personnage de Lok, le second sa chute) offrant son lot de meurtres, de règlements de comptes, de complots et de trahisons avec une violence omniprésente, crue et sèche collant parfaitement avec le ton général de l’ensemble mais qui n’empêche pas le réalisateur de se permettre d’utiliser à de rares occasions un humour noir ravageur (comme dans le premier volet où un des personnages reçoit l’ordre par téléphone de protéger un membre de son clan qu’il vient juste de tabasser furieusement croyant que c’était un opposant) donnant un petit peu de légèreté dans cette histoire (les deux films forment véritablement un tout) désespérément noire. Une noirceur due également à la mise en scène jouant beaucoup sur les clairs-obscurs et l’absence de personnages positifs. Car si on peut prendre le parti de Lok dans le premier film, son acte à la fin (il tue son rival par traîtrise et la femme de celui-ci devant les yeux de son enfant) nous le rend beaucoup moins sympathique, enfonçant définitivement l’image cinématographique héroïque des mafieux. Non, il n’y a pas de héros dans les triades juste des traitres avides de pouvoir, un pouvoir auquel on ne peut accéder que par la voie de la violence et du sang, de la corruption et de la dictature : l’action se situe en 1997, c'est-à-dire lors de la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Ainsi Johnnie To cache à peine son inquiétude pour sa ville laissée au gouvernement chinois comme à travers le personnage de Jimmy voulant redevenir honnête mais qui devient prisonnier d’un système dont il ne pourra pas s’échapper. Pessimiste mais encore une fois réaliste. 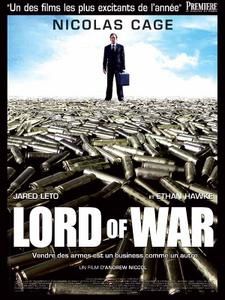 Le maître de guerre
Le maître de guerre

La vie est dure
 On ne vit que 5 fois
On ne vit que 5 fois Flower Power
Flower Power
 Monstres & Camionnettes
Monstres & Camionnettes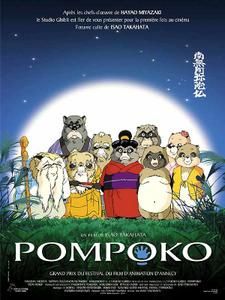 Le bonheur est dans le pré
Le bonheur est dans le pré Danse avec la nature
Danse avec la nature Once upon a time in China
Once upon a time in China Casino Royale
Casino Royale Vous avez vos papiers ?
Vous avez vos papiers ?C’est vrai que d’apparence le dernier film de Albert Dupontel paraît plus sage et moins trash que ses précédents films. L’acteur/réalisateur s’est calmé avec l’âge mais cela ne veut pas dire qu’il a perdu toute sa verve bien au contraire. Avec Enfermés dehors il signe une comédie plus familial si je puis dire sur un problème de société, les SDF. Un sujet de société qui avec l’arrivé des grand froid devient tout à coup une préoccupation majeure pour les hommes politiques en quête de l’Elysée, enfin bon. Plutôt que d’évoquer le sujet avec réalisme et misérabilisme Dupontel choisit la comédie satirique acerbe (tout le monde en prend pour son grade), cartoonesque à la limite de Tex Avery mais également une comédie humaniste dont l’ombre de Charlot plane sur tout le film. Comme Charlie Chaplin, Dupontel interprète un marginal humaniste qui évolue dans une société d’en plus en plus dépourvu. C’est comme même plus intéressant et drôle que des bobos et des beaufs en vacances (toutes allusions à des comédies pouraves à succès de 2006 n’est pas fortuite).
 La nuit anglaise
La nuit anglaise
Imaginez La nuit américaine de Truffaut transposé dans une comédie anglaise et vous aurez une petite idée de ce que réserve ce Tournage dans un jardin anglais. Le film se présente donc comme une mise en abyme du cinéma où l’on suit les (més)aventures d’une équipe de tournage lors d’une adaptation d’un grand best-seller. Un peu près tout les tracas qu’un tel projet peut susciter nous sont ainsi montrés : caprice de vedettes, budgets qui grossit et diminue sans cesse, grosse scènes de batailles qui foirent, engueulades…. j’en passe et des meilleures. Le tout oscillant entre faux-documentaire et comédie à l’anglaise, interprété par des acteurs venu se moquer de leurs images. C’est très drôle et très réaliste et nous rappellent qu’un tournage c’est une multitude de petites histoires humaines, de peines, de joies pour en arriver à produire le plus souvent un film quelconque.
 Génial mes parents divorcent !
Génial mes parents divorcent ! J’ai encore rêvé d’elle…
J’ai encore rêvé d’elle… Space Oddity
Space Oddity
 Femmes aux bords de la crise de nerfs
Femmes aux bords de la crise de nerfs Mesdames, Messieurs...bonsoir
Mesdames, Messieurs...bonsoir Bloody Tuesday
Bloody Tuesday
 Queen Suicide
Queen Suicide Priscillia, folle du Far West
Priscillia, folle du Far West Je viens te dire que je m’en vais
Je viens te dire que je m’en vais Alice au pays des horreurs
Alice au pays des horreursPourquoi Cannes se force à programmer des films de genre dans sa sélection officielle, si c’est pour au final les snober ? Car le chef d’œuvre de Guillermo del Toro n’aurait pas volé la palme d’or. Comme L’échine du diable, Guillermo retrace une page sombre de l’histoire d’France à laquelle il ajoute une touche de fantastique. En résulte un film fabuleux sur la perte de l’innocence et le passage douloureux de l’enfance à l’âge adulte. L’enfance qui sera la victime d’un monde destructeur où le véritable monstre ne se trouve dans le monde des contes mais bien chez l’homme. Et on n’est pas prêt d’oublier le personnage de Vidal, joué par un Sergi Lopez impérial, véritable « motherfucker » du septième art. Un film à la fois violent et beau, tragique et magnifique. Guillermo est un génie et se permet d’inventer la « dark fantasy » et ça méritait bien la première place dans le classement des films fantastiques.
 Incassable
IncassableUne infirmière est engagée dans un hôpital pour enfant où des évènements étranges se produisent : les enfants subissent des fractures inexpliquées. Est-ce du à des mal traitements de la part du personnel ? Où est-ce l’œuvre de la « Mechanical girl » comme le prétend la jeune Maggie, une enfant mourante. Continuant sa réflexion sur l’enfance et ses troubles, Balaguero transcende une « ghost story » des plus classique et signe son meilleur film à ce jour. Oubliant au passage le montage hyper « cut » de Darkness, il fait place à une réalisation faite de longs plans qui permettent d’insuffler un climat inquiétant et à une émotion qui éclate dans un final bouleversant. A cela s’ajoute une Calista Flockhart qui gagne ses galons d’actrice de cinéma. Sorti chez nous directement en DVD, le film méritait amplement les honneurs d’une sortie en salles. Honte à vous messieurs les distributeurs !!!
C’est à la fois un film de monstre digne des plus grand « kaiju eiga », une comédie burlesque franchement drôle et une satire politique virulente contre les autorités coréennes et l’administration Bush. Un mélange des genres qui aurait du donner un film foutoir et bancal, mais voilà c’est le réalisateur de Memories of Murder qui est aux commandes et c’est pas ridicule une seule seconde et c’est jouissif à souhait. Les acteurs sont excellent, en particulier Song Kang-Ho (ce mec peut tout jouer) et la créature est superbe.

Le pacte des fous

 Il faut sauver le soldat Mohammed
Il faut sauver le soldat Mohammed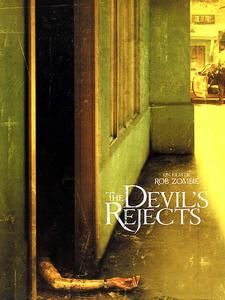 On ira tous au Paradis
On ira tous au Paradis Delivrance
Delivrance Bonjour les vacances !
Bonjour les vacances ! Una bella conzone
Una bella conzone  Deux flics ami-ami
Deux flics ami-amiDès son introduction sans aucun générique, sans présentation des personnages on a compris qu’on n’aura pas à faire à une simple adaptation d’une série T.V des années 80 mais bel et bien d’un film d’auteur, d’un film de Michael Mann. Et pourtant ce n’était pas gagné : un scénario minimaliste digne d’un banal buddy movies (deux flics s’infiltrent chez des truands, l’un s’éprend de la femme du boss) et des problèmes de productions (ouragans, grève de techniciens, Collin Farell partit en cure de désintoxication et caprices de diva de la part de Jamie Foxx) laissait présagé d’un four artistique. Et bien non !!! Michael Mann est un génie et transcende une intrigue franchement légère en retirant tout élément hollywoodien (l’humour) pour complètement réinventer le buddy movies. Il réalise une très belle histoire d’amour à la beauté formelle (visuellement c’est magnifique) doté de quelques scènes d’action époustouflante où chaque acteur se révèle parfait même des seconds rôles très peu définis qui arrivent malgré tout à exister. Miami Vice est une œuvre crépusculaire comme seul Michael Mann sait les concocter.
Résumer The Fountain juste à un simple film de science-fiction se serait vraiment limiter toute la richesse de cette ambitieuse histoire d’amour déclinée sur trois époques, véritable fable métaphysique et philosophique sut le caractère inéluctable de la mort. Darren Aronofsky qui a connut d’innombrables problèmes de production, s’en tire avec tous les honneurs et offre une œuvre sincère, belle, touchante et apaisante (la musique est tout bonnement géniale) proposant une vision optimiste de la mort qui loin d’être la fin de toute chose n’est qu’en fait une renaissance. Un film qui va faire date.

Bienvenue dans un futur pas si lointain. Un futur où toutes les femmes du monde entier ne tombent plus enceinte depuis presque une vingtaine d’années, condamnant ainsi toute l’humanité entière qui sombre dans le chaos. Avec Les fils de l’homme, Alfonso Cuaron s’essaye à la science fiction et le résultat est fantastique. En adoptant une mise en scène proche de celle du documentaire, Alfonso Cuaron nous plonge de plein fouet dans notre propre actualité. Celle du terrorisme, de la peur, de la pauvreté, de l’exclusion… Et en prime il se paye le luxe de livrer deux plans séquence d’anthologie à couper le souffle.
 Le (méchant) petit chaperon rouge
Le (méchant) petit chaperon rouge


 Only the strong…
Only the strong… Quoi ma gueule qu’est quelle a ma gueule…
Quoi ma gueule qu’est quelle a ma gueule…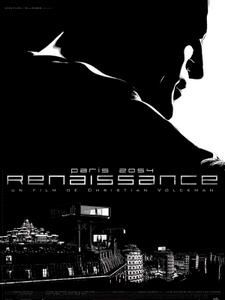


Rush Hour 4
 C’est un avion, c’est un oiseau…non c’est Superman !
C’est un avion, c’est un oiseau…non c’est Superman !C’est pour relancer les aventures de l’homme d’acier que Bryan Singer à abandonné la franchise des X-Men. Un choix qui s’est avéré être une sacrée erreur : le troisième épisode plombe toute la trilogie et ce Superman n’a de super que le nom. Pourtant l’homme semblait fait pour un tel projet, c’est lui qui a relancé avec brio les adaptations de supers héros et il est fan de la première heure du film originel de Richard Donner. Oui mais voilà Singer est trop fan. Superman Returns est une suite-remake qui reste trop collé au film de 1979 dans lequel le réalisateur veut trop rendre hommage et répète les mêmes erreurs que pour ses X-Men, c'est-à-dire qu’il oublie qu’avant tout Superman est un super-héros et effectue des actes de super-héros. Le film se montrant un peu avare en scènes d’action qui rende le film ennuyeux par moment (la fin est beaucoup trop longue) bien que dans le fond il se révèle intéressant. Singer essaye de réinstauré la mythologie du personnage dans le monde post 11 septembre, un monde complètement dénué de héros. Mais en matière mythologie de super-héros et d’action avec homme volant deux réalisateurs ont déjà fait leurs preuves dans une trilogie cultissime qui démontrait qu’ils étaient les hommes faits pour un tel projet: les frères Wachowski.
 Aux armes citoyens !
Aux armes citoyens ! Blanche Neige et les sept voisins
Blanche Neige et les sept voisins Un film de Darren Aronofsky
Un film de Darren Aronofsky Jusqu’au bout du rêve
Jusqu’au bout du rêve L’amour à mort
L’amour à mort Requiem for love
Requiem for love